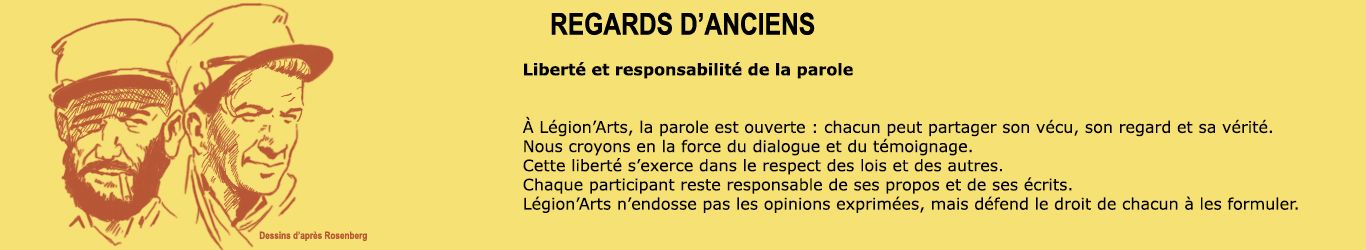Maudite soit la guerre…
Bientôt l’anniversaire de la fin du premier conflit mondial. Le 11 novembre 1918. Ce jour-là, l’armistice était signé à 05 heures 15 du matin et marquait la victoire des Alliés avec la défaite totale de l’Allemagne.
En fait, le “cessez le feu” sera effectif à 11 heures 00 entraînant dans la France entière des volées de cloches et sonneries annonçant à la population la fin de la guerre qui a fait plus de 8 millions de morts, d’invalides et de mutilés.

Aux instants des commémorations qui marqueront jusqu’en 2018, le centenaire de la guerre 1914 – 1918, il serait intéressant de se rétro-projeter en 1922. Pourquoi 1922 ? Parce-que cette année-là, quatre ans après l’armistice, la proposition de célébrer la date de la fin des hostilités est pour les Français l’occasion de dénoncer la responsabilité de l’Allemagne impérialiste dans le déclenchement de cette guerre. Cependant, pour bon nombre d’anciens combattants, il serait vain de rechercher un éloge de l’Armée ou une exaltation de la force française, l’appel fait à la Société des Nations est souhaité comme l’insistance mise sur les deuils et les sacrifices qui doivent prendre plus de relief et servir de leçon…
Le refus de faire du 11 novembre l’occasion d’une manifestation militaire est explicité par différentes interventions et en particulier au congrès de l’Union Française en ces termes :
“La fête du 11 novembre ne comportera aucune manifestation militaire. Dans toute la France des couronnes seront déposées au pied des monuments aux morts par les représentants des Associations d’Anciens Combattants et de Mutilés assistés par les représentants du gouvernement et des Corps constitués”.
De même à la fin de l’article qu’il consacre à la façon de célébrer la nouvelle fête nationale, le journal des mutilés se fait précis :
“Ce qui importe enfin, c’est que la fête du 11 novembre soit dépourvue de tout apparat militaire. Ni prise d’armes, ni revues, ni défilé de troupes. C’est la fête de la Paix que nous célébrons. Ce n’est pas la fête de la guerre. Nous voulons qu’on laisse les vivants tout entiers au souvenir d’une heure où ils ont précisément savouré l’admirable pensée qu’ils allaient désormais pouvoir vivre pour des œuvres de paix, pour des œuvres civiles.”
Mais alors, les drapeaux, les clairons, les Marseillaises ? Le déroulement des cérémonies du 11 novembre ne trahit-il pas ces intentions ? N’est-il pas une concession au militarisme ? “ Absolument pas, si l’on consent à déchiffrer ces cérémonies comme un ensemble de signes articulés. Le lieu de la manifestation, comme le nom l’indique, est le monument aux morts. Ce n’est pas un autel de la Patrie, mais une tombe. Certains, il est vrai, arborent un poilu triomphant, encore que le plus grand nombre soient de simples stèles, sans connotations glorieuses ou cocardières. De toute façon, le monument joue dans la cérémonie le rôle d’une tombe. C’est éclatant dans certaines communes catholiques, où l’on se rendait en “procession”, clergé en tête, de l’église où vient d’être dite la messe des morts, au monument où le prêtre donne l’absoute, tandis que la chorale chante le “De Profundis”. Partout, le monument est fleuri collectivement– souvent, chaque enfant des écoles y dépose une fleur ou un petit bouquet – la minute de silence qui suit est une forme laïcisée de la prière, et l’appel des morts, est emprunté au nécrologe de la liturgie catholique, cela s’inscrit dans la ligne de conduite des cérémonies funéraires.
Le 11 novembre, devant les monuments, on ne célèbre pas le culte de la Patrie victorieuse, mais celui des morts. C’est si vrai que les chants patriotiques sont rares. Ici où là, on chante la “Marseillaise”. Encore faut-il souligner qu’à cette époque, pour cette génération, ce chant n’est pas annexé par des partis politiques : c’est l’hymne national, celui des révolutionnaires de 1789, celui de la République. Le 11 novembre, on ne célèbre pas le nationalisme face à l’étranger, mais le citoyen mort pour la liberté, c’est ce que confirme le sens des échanges et des déplacements. La cérémonie n’est pas présidée par les officiels, mais par les combattants qui se rangent symboliquement avec leurs drapeaux du côté du monument, c’est à dire du côté des morts. Les officiels viennent et déposent une gerbe ou couronne : ce sont eux qui bougent et marquent du respect aux morts. Pour s’associer à cet hommage, les drapeaux s’inclinent respectueusement, en signe de deuil”. Ce qui est grand, ce n’est pas la Patrie, entité abstraite, ce sont les citoyens, dont les noms sont gravés sur le monument dans l’ordre alphabétique, ou dans l’ordre chronologique de leur mort, mais exceptionnellement dans l’ordre militaire des grades. Comment pourrions-nous ne pas regarder avec nos yeux d’aujourd’hui ces mots exprimés en conclusion sachant ce qui s’est passé ensuite en 39-45, Indochine, Algérie et de nos jours avec ces guerres modernes qui détruisent et modèlent l’humanité tout entière :
“Si tout l’effort produit et tout l’argent dépensé…pour la guerre l’avaient été pour la Paix…? Pour le progrès social, industriel et économique ? Le sort de l’humanité serait bien différent. La Misère serait en grande partie bannie de l’Univers, et les charges financières qui pèseront sur les générations futures, au lieu d’être odieuses et accablantes seraient au contraire des charges bienfaisantes de félicité universelle. Maudite soit la guerre et ses auteurs !”.
Quand on entend dire par quelqu’un qui n’a pas combattu : “la guerre est une calamité dont il faut à tout prix éviter le retour”, nous avons la sensation, que celui qui fait cette réflexion n’en peut mesurer exactement la signification. Il nous semble que le souhait qu’il exprime ne peut qu’être platonique. Osons dire aujourd’hui que la guerre pour les combattants de 14-18 aura été “une lutte effroyable, désespérée contre la terre, la terre qui absorbe, engloutit, happe les êtres, dans une boue gluante, mouvante, par des milliers et des milliers de tentacules invisibles: la terre où l’on creusait du même coup de pelle-bêche son abri et sa tombe; la terre dans laquelle on vivait, dans laquelle on mourait, mettant un terme à des souffrances inimaginables; la terre, la boue faite de nos sueurs, de nos larmes, de notre sang presque autant que des eaux du ciel. La guerre pour nous, ce n’est pas la douleur des autres, la misère des autres, c’est “notre” douleur, “notre” misère, c’est pour nous la réalité de toutes atrocités”.
Toujours avec les yeux d’aujourd’hui, je vous invite à apprécier les directives conséquences de cette “après-guerre” en 1922, pour l’action qui devait suivre :
“L’heure n’est plus aux expédients, aux solutions parcellaires. Il faut avoir le courage de voir grand et de préparer un ordre nouveau. La cause profonde du mal est dans les esprits. La réforme primordiale est celle de l’esprit public. Il faut : - Servir au lieu de se servir. - Remplir ses devoirs avant de réclamer ses droits. - Placer les valeurs morales et spirituelles au-dessus des valeurs matérielles. - Combattre le sectarisme sous toutes ses formes et d’où qu’il vienne. - Retrouver le sens du foyer familial. - Restaurer la dignité humaine. - Avoir le courage d’exiger la suppression rapide des abus, des sinécures, des cumuls. - Frapper sans pitié la corruption, partout où elle se trouve et si haut placé que soient les coupables. - Rétablir l’ordre social sur ses deux bases naturelles : la Famille et la Profession. - Restaurer l’autorité, la pourvoir d’une stabilité suffisante, la libérer de l’intolérante tyrannie des partis et des groupements, des appétits et des forces d’argent. - Assurer une stricte séparation des pouvoirs, l’indépendance de la magistrature. - Eviter les impôts excessifs et l’inflation génératrice de misère et de ruine. - Simplifier la comptabilité publique et supprimer la paperasserie administrative inutile et coûteuse. "
Malheureusement ce discours pourrait encore être tenu aujourd’hui… Avec le recul de quelques 107 années, le bilan est éloquent, oui, vraiment : “maudite soit la guerre et ses auteurs…”
Christian Morisot
.
Partagez votre écrit
Anciens de la légion: sur des sujets légion et autres.
Sympathisants: sur des sujets légion.