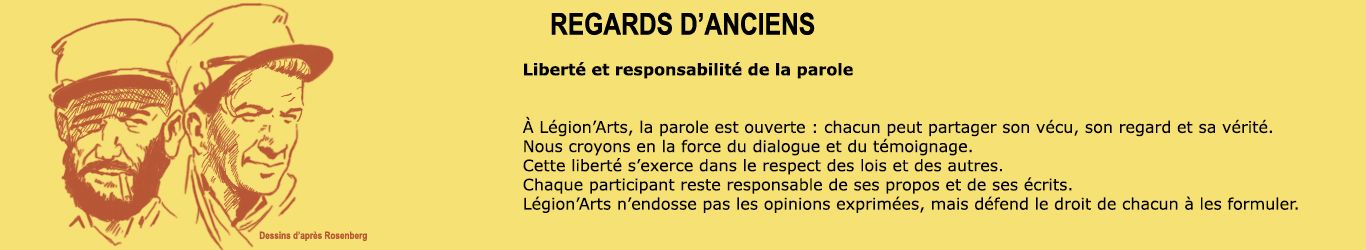Devoir de mémoire ou commémoration ?
Cette année notre association a de nouveau participé au 83ᵉ anniversaire des convois de déportation du camp des Milles vers Auschwitz, présenté comme un « devoir de mémoire ».
Mais que signifie réellement cette expression que l’on entend souvent lors des cérémonies du 14 juillet, du 11 novembre ou de Camerone ?
Ont-ils raison de parler de « devoir de mémoire » ?
La commémoration
Une commémoration consiste à entretenir le souvenir d’un événement à travers une date, un monument, un nom de rue ou une cérémonie.
Elle honore un épisode marquant de l’histoire nationale ou internationale et vise à rassembler la communauté autour d’une mémoire partagée.
Les commémorations rappellent, célèbrent et transmettent.
Le devoir de mémoire
Le devoir de mémoire, lui, a une portée différente.
Il vise à prévenir l’oubli collectif et à éviter la répétition des dérives idéologiques qui ont conduit à des persécutions.
Il ne s’agit pas simplement de rendre hommage, mais de tirer une leçon morale de l’histoire.
Apparue dans les années 1990, bien après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, l’expression s’est ensuite étendue à d’autres tragédies, comme l’esclavage ou le génocide arménien.
Elle traduit une obligation morale : se souvenir des victimes pour que de tels drames ne se reproduisent jamais.
Pour les États, ce devoir est essentiel, surtout lorsqu’ils portent une part de responsabilité.
Il s’oppose à l’ancienne tradition des traités d’amnistie, qui imposaient l’oubli au nom de la paix.
Le devoir de mémoire rappelle au contraire que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles, c’est-à-dire toujours susceptibles de poursuites, même des décennies plus tard.
Alors, lors de la cérémonie de Camerone :
S’agit-il d’un devoir de mémoire, ou simplement d’une commémoration ?
Louis Perez y Cid
.
Partagez votre écrit
Anciens de la légion: sur des sujets légion et autres.
Sympathisants: sur des sujets légion.