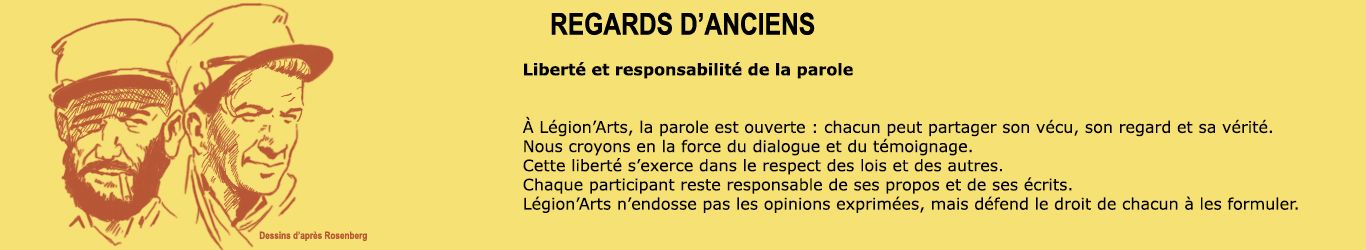Du bien-fondé des amicales
et de l’intolérance de certains
Par Antoine Marquet
Je viens de lire, sur Facebook, le désarroi d’un ancien chef de peloton qui s’est « permis » — le malheureux ! — de donner, de manière courtoise, sur la page d’un autre ancien, son opinion sur un général estimé de celui-ci. Il s’est aussitôt fait insulter, malmener, puis bloquer, sans même qu’on lui laisse le droit de réponse.
Belle preuve d’ouverture d’esprit envers un camarade légionnaire qui a servi sous les ordres du général en question, alors que celui qui poussait des cris de vierge effarouchée était déjà retraité… et sans doute moins légitime à donner son avis.
Le congrès triennal de la FSALE et de ses amicales s’est tenu cet été au 4e Étranger, creuset philosophal de la Légion, où le vulgum pecus qui a eu le courage de « pousser la porte » se transforme en légionnaire. Puis, au sein de son futur régiment il devient un soldat aguerri, s’endurcissant chaque jour par un entraînement exigeant qui le prépare aux combats les plus durs.
Puis vient le retour à la vie civile. Un nouveau monde s’ouvre à lui, et il peut, s’il le souhaite, rejoindre une amicale d’anciens légionnaires.
.jpg?t=17dd34a1_7cef_4edb_a5bf_05202457291f)
Voulues par nos très augustes anciens du début du siècle dernier, ces amicales jouaient alors un rôle essentiel. Durant des décennies, les légionnaires rendus à la vie civile éprouvaient de grandes difficultés à s’insérer dans la société. Tous avaient servi la France loin du territoire métropolitain — exception faite des combattants des deux guerres mondiales — et devaient s’adapter à un environnement souvent hostile. Trouver du travail, se loger, se soigner, survivre : rien n’était aisé.
Les amicales, ainsi que la création de la Maison d’Auriol dans les années trente, puis de Puyloubier dans les années cinquante, ont constitué un bienfait majeur pour la communauté légionnaire. Tous ces anciens partageaient non seulement la condition de légionnaire, mais aussi l’expérience des guerres — à une époque où le monde marchait encore au pas de l’homme.
Les amicales, ainsi que la création de la Maison d’Auriol dans les années trente, puis de Puyloubier dans les années cinquante, ont constitué un bienfait majeur pour la communauté légionnaire. Tous ces anciens partageaient non seulement la condition de légionnaire, mais aussi l’expérience des guerres — à une époque où le monde marchait encore au pas de l’homme.

La métropolisation des régiments a changé la donne. Il y eut ceux qui avaient « fait l’Algérie », parmi lesquels certains n’y avaient fait que l’instruction ou le brevet para, puis les autres — ceux de Corse, puis de Castelnaudary. Il fallut attendre sept années après le conflit algérien pour que la Légion soit de nouveau engagée au combat, au Tchad.
Pendant cette période, courte pour l’histoire mais longue dans la vie d’un homme, les jeunes anciens furent parfois reçus froidement dans les amicales : on les jugeait « sans campagnes », donc sans valeur. Une sorte de légionnaires au rabais !
Pendant cette période, courte pour l’histoire mais longue dans la vie d’un homme, les jeunes anciens furent parfois reçus froidement dans les amicales : on les jugeait « sans campagnes », donc sans valeur. Une sorte de légionnaires au rabais !


Les conflits modernes ont ensuite offert aux nouvelles générations l’occasion de se distinguer à leur tour. La guerre du Golfe, qui vit le rétablissement de la croix de guerre — disparue depuis l’Indochine —, fit sans doute grincer quelques barbes :
« Ah, mais cette croix de guerre-là, ce n’est pas la même… »
Comme si la balle tueuse portait une étiquette : Made in Indochine, Made in Irak, ou plus tard Made in Afghanistan !
La béance entre anciens et plus jeunes s’est maintenue, sinon élargie.
« Ah, mais cette croix de guerre-là, ce n’est pas la même… »
Comme si la balle tueuse portait une étiquette : Made in Indochine, Made in Irak, ou plus tard Made in Afghanistan !
La béance entre anciens et plus jeunes s’est maintenue, sinon élargie.

À cela se sont ajoutés des particularismes que je considère — de mon point de vue exclusif — superfétatoires : amicale des anciens paras, du 2e REI, des Chinois, des Coréens, des motards… pourquoi pas demain celle des anciens du gaz ?
Aujourd’hui même, l’existence d’une association des caporaux-chefs d’un régiment étranger de Génie interroge : quels objectifs ? Être ancien légionnaire ne suffirait-il donc plus ?
De la lenteur de l’homme au pas, nous sommes passés à la vitesse du cheval au galop, mors aux dents. Les légionnaires s’intègrent désormais de facto dans le tissu national, leurs origines se sont considérablement élargies, ils voyagent, se dispersent, et ressentent moins le besoin de se regrouper. Les amicales se réunissent deux ou trois fois l’an, ou, dans les grandes villes, chaque semaine, pour jouer aux cartes, chanter, écouter une conférence ou commenter la dernière prise d’armes — dans cette Légion « qui n’est plus comme avant… comme celle de mon temps ! »
Tout cela relève, à mes yeux, de la foutaise et de la guerre de clans inutile.
Et si les plus anciens cessaient de prendre les plus jeunes pour des bons à rien, et les plus jeunes de voir en leurs aînés de « vieux, voire de très vieux cons » ?
Tous y gagneraient, car l’union fait la force. Et cette force, celle des anciens regroupés malgré leurs différences, pourrait contribuer à maintenir la pérennité de l’image que le monde se fait de notre institution — et à soutenir celle-ci sur des sujets que les actifs ne peuvent aborder.
Pour s’en convaincre, il suffit d’évoquer le symbole de la loi « Français par le sang versé ».
Je veux bien croire que le recrutement se porte bien. Jamais on n’a autant parlé de la Légion. On a même fait du Bureau de Recrutement un quasi-corps de troupe !
Aujourd’hui même, l’existence d’une association des caporaux-chefs d’un régiment étranger de Génie interroge : quels objectifs ? Être ancien légionnaire ne suffirait-il donc plus ?
De la lenteur de l’homme au pas, nous sommes passés à la vitesse du cheval au galop, mors aux dents. Les légionnaires s’intègrent désormais de facto dans le tissu national, leurs origines se sont considérablement élargies, ils voyagent, se dispersent, et ressentent moins le besoin de se regrouper. Les amicales se réunissent deux ou trois fois l’an, ou, dans les grandes villes, chaque semaine, pour jouer aux cartes, chanter, écouter une conférence ou commenter la dernière prise d’armes — dans cette Légion « qui n’est plus comme avant… comme celle de mon temps ! »
Tout cela relève, à mes yeux, de la foutaise et de la guerre de clans inutile.
Et si les plus anciens cessaient de prendre les plus jeunes pour des bons à rien, et les plus jeunes de voir en leurs aînés de « vieux, voire de très vieux cons » ?
Tous y gagneraient, car l’union fait la force. Et cette force, celle des anciens regroupés malgré leurs différences, pourrait contribuer à maintenir la pérennité de l’image que le monde se fait de notre institution — et à soutenir celle-ci sur des sujets que les actifs ne peuvent aborder.
Pour s’en convaincre, il suffit d’évoquer le symbole de la loi « Français par le sang versé ».
Je veux bien croire que le recrutement se porte bien. Jamais on n’a autant parlé de la Légion. On a même fait du Bureau de Recrutement un quasi-corps de troupe !

Les réseaux sociaux aidant, on est passé du mystère qui entourait notre chère Légion à un déballage parfois indécent. Un caporal-chef, index levé comme l’Oncle Sam, explique à tout vent ce qu’est la Légion, le rôle de ses officiers… Des groupes se forment pour vanter tel ou tel, quand leurs parcours se sont parfois déroulés entre cabinets, nuitées Kronenbourg et pistes de cross.
Il faut sans doute de tout cela, mais le recrutement actuel semble souvent motivé par des intérêts sans grandeur : régularisations administratives, accès à la nationalité, stabilité familiale.
Ces légionnaires, pourtant prêts à offrir leur vie à la France, évoluent dans un monde bien différent de celui où les amicales jouaient un rôle vital.
La volonté de s’engager reste la même, mais quelle part de rêve la Légion peut-elle encore offrir ?
L’Afrique s’est refermée, parfois brutalement, deux unités de base subsistent outre-mer, renforcées par du personnel toutes armes — sans exclusivité légionnaire.
Le légionnaire n’est pas du genre à caserner : il lui faut du soleil, de l’espace pour redorer sa carcasse.
Dans un autre dégradé de couleurs, il me rappelle ces régiments français du temps du Pacte de Varsovie, tournés vers l’Est, comme le lieutenant Drogo guettait le Nord, attendant un ennemi qui ne venait pas…
Il faut sans doute de tout cela, mais le recrutement actuel semble souvent motivé par des intérêts sans grandeur : régularisations administratives, accès à la nationalité, stabilité familiale.
Ces légionnaires, pourtant prêts à offrir leur vie à la France, évoluent dans un monde bien différent de celui où les amicales jouaient un rôle vital.
La volonté de s’engager reste la même, mais quelle part de rêve la Légion peut-elle encore offrir ?
L’Afrique s’est refermée, parfois brutalement, deux unités de base subsistent outre-mer, renforcées par du personnel toutes armes — sans exclusivité légionnaire.
Le légionnaire n’est pas du genre à caserner : il lui faut du soleil, de l’espace pour redorer sa carcasse.
Dans un autre dégradé de couleurs, il me rappelle ces régiments français du temps du Pacte de Varsovie, tournés vers l’Est, comme le lieutenant Drogo guettait le Nord, attendant un ennemi qui ne venait pas…

Grâce au Major (er) Pierre Jorand, une séance d’information est dispensée chaque semaine, bénévolement, à ceux qui quittent le service — fin de contrat ou retraite — pour les inciter à se rapprocher de l’amicale la plus proche de leur futur domicile. Son dévouement est admirable… mais déjà, on évoque le coût de ses déplacements !
Pour le bien du plus grand nombre, malgré les obstacles qui surgiront sur le chemin de chaque ancien légionnaire, restons unis malgré nos différences de carrières, de grades, d’ancienneté, de combats ou de destins et tentons de faire vivre nos amicales et augmentons le nombre de leurs adhérents où parfois les sympathisants sont plus nombreux que les anciens légionnaires.
Restons simplement d’anciens légionnaires, unis par ce même courage d’avoir, un jour, « poussé la porte ».
Pour que vive la Légion.
Pour le bien du plus grand nombre, malgré les obstacles qui surgiront sur le chemin de chaque ancien légionnaire, restons unis malgré nos différences de carrières, de grades, d’ancienneté, de combats ou de destins et tentons de faire vivre nos amicales et augmentons le nombre de leurs adhérents où parfois les sympathisants sont plus nombreux que les anciens légionnaires.
Restons simplement d’anciens légionnaires, unis par ce même courage d’avoir, un jour, « poussé la porte ».
Pour que vive la Légion.

Partagez votre écrit
Anciens de la légion: sur des sujets légion et autres.
Sympathisants: sur des sujets légion.